![[Entretien] Bertrand Betsch – Pour mémoire](http://www.pinkfrenetik.com/wp-content/uploads/2018/12/bertrand-betsch-entretien-slider-red-640x265.jpg)
Il y a deux BB dans mon panthéon musical. Benjamin Biolay, qui n’est plus à présenter. Et Bertrand Betsch, à la discographie plus discrète mais pas pour autant moins riche. Loin de là.
Les découvertes musicales sont encore plus marquantes quand elles se font à l’adolescence. C’est à peine majeur que l’album Pas de bras, pas de chocolat, le troisième effort de BB, tombe entre mes oreilles en 2004. Souvenirs de textes joliment crus et mélodies catchy, soutenus par une voix fragile, mais pleine de sincérité. Je me suis ensuite penché sur son premier album, La soupe à la grimace, qui regorge de bijoux (A l’ouverture des miroirs, La complainte du psycho-killer, Passer sous le métro, Les rendez-vous manqués, etc.) Depuis 2010, Bertrand Betsch peut se targuer de sortir minimum un album (BO, inédits, album studio) par an. Seul Jean-Louis Murat semble aussi prolifique dans le paysage musical français aujourd’hui.
Après la sortie de Tout doux en mai dernier, Bertrand Betsch a mis en ligne, de manière plus discrète, l’album Pour mémoire fin août. L’inscription 1997-2017 semble indiquer que ces chansons ont été composées sur près de vingt ans. Elles sont classées machinalement par ordre alphabétique (excepté pour le titre d’ouverture), et semblent pourtant être reliées de manière infaillible. A l’écoute de cet album, c’est tout d’abord la richesse musicale qui frappe (cuivres, guitares, piano, clavier, sampler, melodica entre autres). Les textes semblent traverser le temps, et content l’histoire d’un homme sur deux décennies.
J’ai donc voulu en savoir un peu plus sur ce nouvel album et savoir son point de vue sur l’évolution de la musique depuis 20 ans. Bertrand Betsch évoque sa manière de composer, ses projets parallèles, le cinéma, Bashung et le futur.
![[Entretien] Bertrand Betsch - Pour mémoire](http://www.pinkfrenetik.com/wp-content/uploads/2018/12/bertrand-betsch-entretien-red.jpg)
Pinkfrenetik : Trois mois après Tout doux, tu as dévoilé par surprise Pour mémoire. L’inscription 1997 – 2017 laisse à penser que cet album peut être un recueil de titres que tu as composé sur 20 ans. Peux-tu nous en dire plus ?
Bertrand Betsch : Cet album rassemble des morceaux orphelins composés entre 1997 et 2017. J’entends par « orphelins » des morceaux qui n’ont jamais trouvé place dans aucun de mes albums passés et qui ne rentrent pas non plus dans le cadre des 4 ou 5 albums sur lesquels je bosse actuellement. Cela est sans doute dû au fait qu’ils ont chacun quelque chose de particulier et d’un peu à part par rapport à mes autres productions. Ne pouvant me résoudre à les écarter de ma discographie j’ai décidé de les rassembler dans un seul volume qui ressemble en quelques sorte à ce qui est écrit dans les marges de mes albums « officiels ». Je porte un attachement particulier à chacun de ces titres. Chacun révèle un aspect de ma personnalité et rend compte de ma conception de la chanson, à savoir l’expérimentation et l’ouverture de tout le champ des possibles. Cet album qui est paru le 31 août 2018 a auparavant été dévoilé et offert en 2017 à la centaine de personnes qui ont pré-commandé mon album Tout doux paru le 25 mai 2018. J’avais écrit à l’époque quelques notes de pochette qui apportent un éclairage sur la gestation et l’intention de chacun de ces 16 titres. Je me permets de te les livrer là, à une ou deux retouches près.
En fin d’entretien, retrouvez deux chansons de l’album Pour mémoire, expliqué par Bertrand.
Tu qualifies ce disque sans concession, bizarre et radical. La traversée happe l’auditeur en ouverture avec sa production dépouillée et son texte fort. Certains titres semblent imprégnés de ta riche discographie. A l’hôpital évoque l’ambiance de Pas de bras, pas de chocolat. Atom et le grand magasin ou Onions auraient pu figurer sur BB Sides de par son côté radical. D’autres (La solitude est une mauvaise habitude, Atom et les nains) ont été écrit il y a plus de 20 ans, à l’époque de La soupe à la grimace. Rassembler ces 16 titres t’a t-il permis de prendre du recul sur ta discographie ?
Non, pas du tout. En fait je travaille depuis 25 ans sur un corpus que j’étoffe progressivement de façon à constituer un répertoire qui est mon apport à un corpus plus vaste s’inscrivant dans le domaine de la chanson française. La plupart de mes disques sont en fait une mosaïque constituée de morceaux composés à différentes périodes de ma vie. Arrive un moment où se produit une sorte de cristallisation qui réunit un certains nombre de titres qui n’ont pas été conçus dans la perspective d’un album en particulier. Tout cela est un concours de circonstances. Je trouve un titre d’album, une économie de moyens, une structure pour le produire et le sortir, puis ce titre d’album, comme un aimant, attire à lui une nuée plus ou moins vaste de chansons. Pour finir je fais des choix et à l’arrivée il y a un album. Pour La vie apprivoisée j’avais choisi une vingtaine de titres dans mon répertoire. Pendant un an j’ai fait tourner les maquettes dans ma voiture sans pouvoir me décider. Comme je voulais faire un album aussi ouvert que possible j’ai fini par choisir les morceaux qui me semblaient les plus lumineux. Arrivé en studio j’ai dû écarter deux morceaux car mon producteur ne saisissait pas où je voulais en venir avec ces titres-là (il s’agissait de Ça vaut la peine et de Le creux et le plein). Je les ai donc remplacés par deux autres titres. Un que j’ai composé sur le moment (En sourdine, 2015) et un que j’avais écarté (Qui perd gagne – morceau datant de 1994). Les morceaux figurant sur l’album sont assez variés en termes de chronologie (2014 : Aimez-nous les uns les autres, Qui je fus, La vie apprivoisée, La beauté du monde, Merci ; 2013 : Du vent dans tes mollets ; 2012 : Il arrivera ; 2007 : Les hommes-douleurs ; 1995 : Les inséparables : 1993 : Où tu vas). Sur cet album on a donc une amplitude de 22 ans (1993-2015). En 2015 et 2016 j’ai écrit pas mal de morceaux qui vont se retrouver sur des albums à venir, dont l’album La traversée qui est un gros chantier auquel je commence seulement à m’attaquer en termes de production (au sens de production exécutive). En sortant La vie apprivoisée j’avais cette frustration d’avoir écarté pas mal de titres auxquels je tenais énormément. Comme je sortais d’un album studio avec des moyens relativement importants impliquant un temps long et toute la lourdeur logistique y afférent j’ai vite saisi l’opportunité de faire rapidement et en voyageant léger un album en solo dans mon home studio. J’ai donc rassemblé ces titres auxquels j’ai greffé quelques autres titres et je les ai poussé au bout de ce que je pouvais faire avec les moyens qui me sont propres (à l’exception d’une journée de studio avec la violoniste Salomé Perli et Marc Denis à la prise de son). Ce qui a donné Tout doux qui lui aussi est assez composite (2015 : Chamaille – composé à partir d’un texte datant de la toute fin des années 90 ; 2014 : J’espère ; 2013 : Ça vaut la peine, et Demain toujours ; 2012 : Le vide en soi ; 2009 : Tout doux ; 1997 : La beauté n’est pas pour tous ; 1996 : Tromperie et L’alibi ; 1993 : Le creux et le plein et Quoi vous dire). On a donc là aussi une amplitude de 22 ans.
Si l’on se penche maintenant sur Pour mémoire on a la chronologie suivante qui n’est pas très différente des albums précédents comme tu pourras en juger :
2015 : L’entre deux, La traversée, La vie déviée et Chaos
2013 : Bon anniversaire
2010 : Par delà la mort et Une vie à brûler
2007 : Nulle place et Se taire est impossible
2006 : La paix
2005 : Les vents contraires, réenregistrée en 2011
1998 : Atom et le grand magasin
1997 : Atom et les nains, Onions, A l’hôpital et La solitude est une mauvaise habitude.
J’ai noté 1997-2017 car c’est en 2017 que j’ai finalisé certains arrangements. On a donc une amplitude de 19 ans (1997-2015).
Il n’en reste pas moins que cette page blanche est un peu mon fantasme ultime.
Je m’arrête là. C’est juste pour te donner l’idée que je n’ai de cesse faire des allers et retours dans mon répertoire. Et je compte aller comme ça jusqu’à épuisement des « stocks ». Le but de la manoeuvre est d’arriver un jour à sortir tout ce qui me paraît digne d’intérêt pour enfin me retrouver face à une feuille blanche. Etant donné que j’ai, à l’heure actuelle, 4 albums d’avance et pas mal d’anciens titres encore à exploiter, il y a peu de chances que cela se produise avant un bon bout de temps. Qui plus est il faudrait que je stoppe toute écriture de nouvelles chansons. Il n’en reste pas moins que cette page blanche est un peu mon fantasme ultime. (Parmi les dizaines d’auteurs-compositeurs que j’ai croisés ou côtoyés ces 22 dernières années je suis – à l’exception de Cyrz – le seul à être dans cette problématique-là).
On me dit souvent que je suis très productif. C’est tout à fait inexact. Je pourrais même dire que je suis assez laborieux puisqu’il me faut en moyenne une vingtaine d’années pour sortir un album. D’ailleurs je traverse des périodes où je ne produis que deux ou trois chansons par an. Tout ceci s’explique en partie par le fait qu’au moment où j’ai sorti mon premier album La soupe à la grimace (1997) j’avais déjà plus d’une centaine de chansons à mon actif. Il faut dire aussi qu’entre 1993 et 1997 j’ai été particulièrement productif (ce qui ne se reproduira sans doute jamais).
Tout ça pour te dire que ma vie d’auteur-compositeur est faite d’un seul bloc insécable. C’est un ensemble. Une traversée au long cours…
En 2015, tu as participé la BO du film Deux automnes et trois hivers de Sébastien Betbeder. Comment as-tu abordé ce projet où tu devais poser ta musique sur les images de quelqu’un d’autre ? L’expérience te tente t-elle à nouveau ?
Cette expérience fut très heureuse. Sébastien m’a contacté via Facebook pour me proposer de composer la BO de son film. Il m’a envoyé le scénario au moment où le film était en train de se faire sur la base de séquences où les acteurs se contentaient de lire le scénario à l’écran (un peu comme dans Le camion de Marguerite Duras). Tout le long du process je n’ai d’ailleurs pu visionner qu’une seule de ces séquences où apparaissait Vincent Macaigne, acteur que je ne connaissais pas à l’époque et qui deviendrait par la suite cet immense comédien que l’on sait. J’avoue d’abord avoir été intrigué par ce corps et cette voix si singuliers. Puis j’ai été complètement happé par ce que j’appellerais un « prototype » d’acteur (qui s’opposerait à tous ces acteurs « typiques » et permutables que comptent le cinéma). Je n’ai donc pas directement travaillé sur les images du film car il se tournait très exactement en même temps que j’en composais la BO. Sébastien me donnait juste quelques indications très sommaires mais néanmoins suggestives sur l’ « humeur » des thèmes qu’il désirait. D’entrée il me posa une contrainte. A savoir des choses très dépouillées tenant sur une ou deux pistes maximum. J’ai d’abord vécu cela comme une frustration (je rêvais de choses très arrangées), puis je me suis pris au jeu. J’ai parlé d’expérience heureuse.Je rajouterais que ce travail fut pour moi très facile car autant écrire des textes de chansons est un acte toujours lié à une inspiration soudaine dont je suis plus ou moins tributaire, autant je compose sur commande et comme à l’envi. En l’occurrence (et du fait de la contrainte minimaliste) il m’est arrivé de mettre en boîte jusqu’à trois thèmes par jour. Je composais à flux tendu et j’envoyais chaque soir le jour le fruit de mon travail à Sébastien dont les retours étaient très encourageants et toujours élogieux. Nous étions à ce moment-là en parfaite symbiose. J’ai donc composé une grande quantité de thèmes différents (peut-être une quarantaine). Je précise que je déteste ces BO de cinéma où l’on entend le même thème décliné plusieurs fois avec des arrangements différents. C’est ce que j’appelle la BO du pauvre. Je déteste également toutes ces BO symphoniques en mode néo-classique qui sont l’ordinaire du cinéma français. D’une manière générale il est vraiment très rare que j’apprécie une BO. Très peu m’ont marquées : je citerais spontanément celle de In the mood for love (Wong Kar Waï) composée par Michael Galasso et celle d’Indiana Song (Marguerite Duras) composée par Carlos d’Alessio. Par parenthèse je trouve les BO des séries actuelles bien plus excitantes et inventives que celles de la majorité des films de cinéma contemporains.
J’ai découvert le film à Cannes dans de très bonnes conditions. Le film me plut beaucoup ainsi que l’utilisation de ma musique. Cette escapade de deux jours à Cannes fut d’ailleurs assez cocasse. Le réalisateur, le producteur, l’acteur principal et l’équipe technique étaient logés dans des conditions miteuses très loin du centre névralgique de Cannes alors que pour ma part je bénéficiais d’une chambre d’hôtel 3 étoiles réservée par la SACEM à deux pas des marches du Grand Palais. Je pus ainsi faire la connaisse IRL de Sébastien Betbeder et de Frédéric Dubreuil (le producteur) avec lesquels je garde des contacts espacés mais très bienveillants. Je fis également la connaissance de Vincent Macaigne. Il est de cette catégorie de personnage que l’on croise très rarement dans une vie et qui lorsqu’il se joint à une assemblée monopolise absolument toute l’attention tant il est doté d’une aura hors du commun.
J’eus par la suite beaucoup de messages très positifs concernant le film et la BO. Les commentaires qui me firent le plus plaisir émanaient de gens qui me dirent avoir vu le film sans savoir qui avait composé la BO et qui reconnurent ma « patte » musicale avant le générique de fin. Ce fut une petite victoire personnelle au sens où l’on met généralement plus l’accent sur la qualité de mes textes que sur ceux de mes compositions. Je me suis déjà exprimé sur ce sujet en affirmant qu’un texte n’est « audible » que porté par une musique de qualité. Si la musique ne suit pas, le texte est inaudible. Je veux dire par là qu’il est impossible d’apprécier la qualité d’un texte si la musique qui l’accompagne n’est pas elle-même « remarquable ». Malgré le très bon accueil du film je n’ai pas eu de nouvelles propositions de BO mais je serais bien entendu ravi de revivre ce type d’expérience. Je viens d’ailleurs de finaliser dans mon home studio un recueil de pièces instrumentales que j’ai composées au fil du temps et qui s’intitule Prière d’insérer. J’espère pouvoir le publier d’ici fin 2020.
En plus d’être auteur, compositeur et interprète, tu as aussi créé il y a quelques années ton label Les Imprudences (qui n’est plus actif) afin de mettre en lumière des artistes que tu aimes. Avec les réseaux sociaux, on pourrait penser qu’il est plus simple pour un artiste de se faire connaître aujourd’hui. Peut-être moins de durer. Qu’en penses-tu, toi qui a sorti 12 albums en 20 ans.
Pour ce qui est du label Les Imprudences il ne s’agissait pas de mon initiative. C’est ma femme, Audrey Betsch, qui s’est lancée dans cette aventure et ce fut d’ailleurs une bien mauvaise passe. Je n’ai participé qu’indirectement à cette galère en ce sens que je travaille depuis 2011 sur tous les projets de Jérémie Kiefer en tant qu’arrangeur en charge de la pré-production de ses albums. J’ai pris part à son premier album qui n’a jamais vu le jour et dont il ne reste pour trace qu’un Ep de 4 titres (dit l’Ep rose). J’ai ensuite beaucoup œuvré pour son album Manifeste qui est paru l’année dernière sur Les Imprudences. Ce fut d’ailleurs l’ultime sortie du label. Et j’oeuvre à nouveau pour lui en travaillant sur son prochain album, Exode, qui paraîtra normalement fin 2019 sur le label LaCouveuse.
Pour résumer la vie d’un label c’est 1% consacré à l’artistique et 99% consacré à de l’administratif pur et dur.
Pour en revenir au label Les Imprudences, j’ai vécu de près cette utopie qui s’est vite transformée en cauchemar. Je parle de cauchemar car lorsque vous montez une structure et que vous n’avez pas les moyens d’engager un ou une comptable alors votre vie deviendra un enfer et vous devrez encaisser durement les persécutions de l’URSAF, de Pôle emploi, des Impôts, etc. Il faut savoir que si vous salariez une fois un musicien (chose très difficile tant est lourde la démarche administrative) alors vous devrez justifier et prouver toute votre vie auprès de cinq caisses différentes le fait que vous n’ayez pas employé un autre musicien ou le même musicien les mois suivants. Chaque mois tout est à refaire et cette mauvaise farce ne prend fin que lorsque vous avez fermé le label. Et encore, car rien ne prouve que même sans label vous n’avez pas fait travailler au noir, avec des chaînes au pieds, sous la menace, un pauvre musicien traité tel un sans abri, exploité à coups de ceinturon voire pendu par les pieds. Pour résumer la vie d’un label c’est 1% consacré à l’artistique et 99% consacré à de l’administratif pur et dur. En France on a la liberté d’entreprendre mais pas la facilité. Il faut avoir les nerfs très solides et s’y consacrer à temps plein. Audrey, à l’époque du label, travaillait 50 heures par semaine pour son vrai boulot, et devait se coltiner le soir et les week-end les tracas d’une administration française pour le moins kafkaïenne. On parle de simplification des démarches administratives mais en France tout reste à faire.
Pour répondre à la seconde partie de ta question je dirais qu’il est plus facile maintenant de produire un disque au sens où, avec un simple logiciel de MAO, on peut réaliser tout seul un album et le sortir en auto-produit en le vendant par exemple sur Bandcamp. Les réseaux sociaux sont maintenant essentiels pour se faire connaître, voire pour se faire aider par la communauté des internautes. A condition de n’être pas noyé dans la masse des nouveaux talents (et ils sont effectivement très nombreux). A l’époque où j’ai débuté nous enregistrions des maquettes sur des magnéto 4 pistes à K7 et, d’un point de vue technique, c’était vraiment compliqué car le rendu sonore était affreux. Sur la foi d’un enregistrement dégueulasse vous deviez convaincre un label de vous signer et d’allonger 100 000 ou 200 000 mille francs (15 000 ou 30 000 euros) pour vous faire rentrer dans un studio pour une durée très courte afin d’essayer d’y graver une vague réplique de ce que vous avez en tête. Pour ma part ce fut très compliqué car j’aime avoir du temps et de l’autonomie pour mener un projet à terme. Il m’a fallu attendre fin 2008 pour que je crée mon home studio puis une dizaine d’années pour que je commence enfin à maîtriser les divers aspects la MAO. Même encore maintenant je ne me sens pas légitime en tant que producteur. J’apprends chaque jour un peu. Je progresse lentement avec l’aide des conseils de vrais producteurs tels que Marc Denis depuis 2011 et de quelques autres amis avant lui. Tout est plus facile aujourd’hui, même lorsque vous enregistrez dans un vrai studio car les albums sont maintenant assez souvent envisagés dans un temps long constitué de sessions espacées dans le temps. Avant vous rentriez dans un studio et 15 jours après le disque devait être terminé, mixage compris. Il fallait donc une sacrée maîtrise pour en sortir quelque chose de bien. Aujourd’hui on compte de moins en moins en termes de jours. On compte en terme de titres. Par exemple 1000 ou 2000 euros par titre. Ce qui explique pourquoi tant d’albums de 8, 9 ou 10 titres maximum paraissent aujourd’hui alors qu’avant on tirait facilement un album sur une quinzaine de titres. Le format très ramassé des albums qui paraissent depuis quelques années est présenté comme un choix artistique alors qu’il s’agit essentiellement de la conséquence de contraintes budgétaires.
Pour en revenir à mon cas je dirais que j’ai eu la chance d’arriver sur la scène française à une époque où celle-ci n’était pas foisonnante comme maintenant et où il était donc plus facile d’y faire sa place. En revanche les 10 premières années de ma carrière furent compliquées en termes de sorties car je ne disposais des facilités technologiques d’aujourd’hui en termes de moyens de production.
Le rap a tout emporté sur son passage (pour le meilleur et pour le pire) et la chanson française est devenue en 10 ans une minuscule niche qui n’intéresse plus grand monde et qui n’est soutenue par aucune radio musicale nationale d’envergure.
Mais ce qui a le plus changé entre maintenant et il y a 20 ans c’est qu’aujourd’hui la musique n’ayant plus de réelle valeur marchande il est devenu très difficile d’en faire un métier. Par ailleurs, pour marcher un peu il faut répondre à un cahier des charges esthétiques très précis. Prenez deux nouvelles chanteuses à la voix très fraîche et assez talentueuses toutes les deux : Pomme et Angèle. La seconde explose cette année car elle a adopté tous les codes musicaux et lexicaux en vigueur : ambiance électro et champ lexical à la mode (pour aller vite). En revanche c’est beaucoup plus dur pour Pomme qui se revendique d’une scène folk traditionnelle et qui, malgré les millions de vues de ses clips sur Youtube, peine à vivre de sa musique. Pour ma part c’est un peu différent au sens où je n’ai jamais vraiment vécu de la musique. Cela n’a jamais été qu’un complément de revenus. Je ne me considère pas comme musicien de profession. Je fais cela en amateur à mes heures perdues. Bien sûr, de part mes nombreuses « heures de vol », je bénéficie d’un certain respect auprès de certaines personnes mais mon travail musical s’est toujours inscrit dans une économie minimale et sans réelle portée commerciale. Alors certes je fais à peu près ce que je veux à partir du moment où cela ne coûte pas cher mais cela génère tellement peu de gains que j’ai bien du mal à me considérer autrement que comme un « musicien du dimanche ». Je croise souvent des musiciens plus jeunes que moi pour lesquels je suis quelqu’un d’installé, de « parvenu », pour lesquels « j’ai réussi ». C’est tout à fait faux d’un point de vue factuel. A la sortie de mon dernier album j’ai lu sous la plume de journalistes la phrase suivante : « Ça y est, Bertrand Betsch a enfin percé ». Mais percé quoi ? Le mur de l’indifférence ? Oh que non. Je reste un artiste particulièrement marginalisé et qui ne peut prétendre à aucune considération auprès du secteur moribond de la chanson française. Le rap a tout emporté sur son passage (pour le meilleur et pour le pire) et la chanson française est devenue en 10 ans une minuscule niche qui n’intéresse plus grand monde et qui n’est soutenue par aucune radio musicale nationale d’envergure. Du haut de mes 21 ans de carrière je n’ai qu’une seule certitude et qu’un seul conseil à donner : faites la musique qui vous plait mais n’attendez rien en retour et surtout, surtout, ayez un vrai job à côté.
As-tu des coups de cœurs récents à faire partager ?
En amont de Bashung.
Qu’est-ce qui distingue un grand artiste d’un artiste lambda ? Les grands artistes sont immortels. La preuve en est que dix ans après sa mort Bashung sort un tout nouvel album, peut-être son meilleur. Le disque s’ouvre d’ailleurs très justement par cette phrase de Dominique A : “Mortels, mortels, nous sommes immortels”. Comme en écho au livre de Dominique A, “Un bon chanteur mort”. La voix de Bashung ne m’a jamais parue si proche et son talent d’interprète aussi fort. Il y a plusieurs Bashung. Le premier Bashung, rockeur des années 80 téléguidé par les calembours de Bergman (quelques albums pas vraiment impérissables). La parenthèse miraculeuse de sa collaboration avec Gainsbourg sur le magnifique mais très rugueux “Play Blessures”. Un deuxième Bashung plus subtil servi par les calembours de Fauque (avec des choses plus qualitatives malgré un manque d’inspiration musicale et des arrangements très datés sur certains albums tels que “Chatterton”). En 1991 paraît “Osez Joséphine”, grand album de blues, son disque le plus personnel et dans lequel Bashung livre son ADN musical. Mais c’est sur le tard que Bashung s’ouvre le chemin de la gloire pérenne en faisant de plus en plus appel à des collaborateurs souvent très inspirés. Arrive alors le tiercé gagnant : “Fantaisie militaire” (sommet de sa collaboration avec Fauque), “L’imprudence” et “Bleu pétrole”. La vie de Bashung fut celle d’un chanteur rock un peu trop pudique. Pudeur qui lui aura donc fait se cacher trop longtemps sous une voix un peu gouailleuse et sous la “figure imposée” du jeu de mots (ne s’épargnant pas le lourdingue par endroits mais tutoyant parfois les sommets lorsque son verbe se fait lacanien, voire mallarméen). Finalement le Bashung que j’aime le plus c’est celui qui dépose son chapeau à terre et se met à nu sur “Montevideo”, morceau d’anthologie magnifiquement ajusté par Mickaël Furnon. Du voyou un peu rock dandy et poseur de “Gaby” à l’incroyable solennité de l’interprète d’« Immortels », il y a tout un parcours qui me donne à penser que Bashung nous a quitté au moment où il arrivait enfin à maturité. Il est assez rare qu’un chanteur meurt avant d’avoir pu donner le meilleur de lui-même. C’est malheureusement le cas de Bashung qui avec cet album sorti des limbes fait de nous des orphelins inconsolables. Bashung a mis beaucoup de temps à trouver sa voix/voie. Lorsque l’on écoute ses reprises d’« Avec le temps », “Les deux amants”, “Le sud”, “Céline”, “Bruxelles”, “Les mots bleus” et la parfaite maîtrise vocale d’« En amont » on finit par penser que Bashung était avant tout un interprète, l’un des plus grands, sinon le plus grand (du moins en France).
Grand Turn Over de Foray. Foray s’est d’abord appelé Nord (et a sorti sous ce nom son désormais légendaire Ep L’amour s’en va en 2016) puis il a dû changer de patronyme. Son premier album est inusable. Une sorte d’électro-folk en français dans le texte. Grand Turn Over est sans doute l’album de l’année.
Pupille de Jeanne Herry et Le grand Bain de Gilles Lellouche.
Ces deux films se distinguent par la qualité de leur mise en scène. C’est toujours par la mise en scène que la magie du cinéma opère. En regardant “Pupille” j’ai été saisi par la justesse des nombreux champs / contre-champs entre le nourrisson et les adultes : c’est par l’enchaînement de ces plans que jaillit l’émotion. Avant d’être le récit d’une adoption, ce film est une histoire de regards échangés, de pupilles dilatées afin de laisser filtrer toute la profondeur et la subtilité des sentiments humains. Avant d’être un raconteur, un cinéaste est avant tout un œil et une oreille. Filmer c’est opérer sur du vivant. C’est la marque des grands cinéastes que de nous apprendre à voir, à écouter, à regarder, à nous imprégner.
J’ai beaucoup ri en regardant “Le grand bain”. J’ai aussi été ému. Rares sont les comédies réussies. Encore plus rares celles qui suscitent un rire aussi réparateur. Car le sujet de ce film n’est-il pas finalement l’apprentissage (ou la reconquête) de la dignité ?
Merci Bertrand pour tes réponses !
Ci-dessous, retrouvez deux chansons de l’album Pour mémoire, commentées par Bertrand Betsch.
7) L’entre deux : Ecrit en 2015.
Exercice de style consistant à épuiser, à exténuer le verbe jusqu’à lui faire rendre gorge. Se donner le temps de tout dire, d’énumérer toutes les possibilités pour finir par comprendre que jamais l’on ne peut trancher dans le doute. Il y a dans la vie une part d’indéfini, d’incertitude, de difficulté à nommer les choses. Il y a de l’innommable (pour reprendre Beckett). La vie comporte une part d’aporie, de grand embarras. On ne sait pas toujours exprimer les choses. On cherche les mots pour le dire. Le langage se dérobe. On voudrait accéder à la bonne terminologie. On cherche le mot exact. « Non, ce n’est pas ça, ce n’est pas tout à fait ça », comme je le dis dans Chroniques terriennes. Nous vivons dans le dogme du binaire. C’est ça ou ça. Il faut choisir. Sauf que des fois ce n’est ni ceci ni cela, c’est entre les deux. Nous sommes sommés d’accéder à l’exactitude du langage mais le langage se dérobe sous la langue et parfois aucun mot ne peut recouvrir avec exactitude ce que l’on ressent. Il y a de l’indéfinissable, de l’inconnu. Il y a beaucoup d’incertitude. Il faut choisir son camp nous dira-t-on. Sauf que des fois, c’est plus compliqué que ça. Parfois les mots ne nous sont d’aucun secours. La pensée ne peut alors aboutir. Il faut se résoudre à errer dans la zone du non-dit, du non révélé, dans une sorte d’entre deux. Le langage est notre bouée de sauvetage. Et parfois la mer est forte.
9) La solitude est une mauvais habitude : Ecrit le 16/06/1997.
Chanson écrite au moment de la sortie de La soupe à la grimace. J’ai gardé ce que j’avais enregistré à l’époque : la guitare électrique principale, les claviers, le mélodica et la boîte à rythmes. J’ai refait la voix, rajouté des choeurs, des guitares électriques, des claviers sur la partie finale ainsi que des éléments percussifs. J’ai également rajouté les phrases qui commencent à partir de « A la solitude j’ai tant donné… ». J’aime beaucoup cette fin où la musique se délite progressivement pour laisser place à un choeur tragique.
Chanson largement autobiographique. J’étais alors célibataire depuis cinq ans et j’en souffrais beaucoup. C’était bien sûr de ma faute puisqu’à partir de mon entrée à l’université je m’étais employé à fuir tout contact humain. Cinq ans c’est aussi le temps qu’il m’a fallu pour guérir de mon premier chagrin d’amour.
J’ai détesté être jeune. J’ai détesté les jeux de séduction. Le monde et les filles me faisaient peur. Atteint d’une sorte de phobie sociale, je ne savais comment me comporter en société. Je faisais le vide autour de moi. Les jeunes fumaient des joints, dansaient, flirtaient, s’amusaient. Moi j’étais raide comme la justice, sérieux comme un pape et si je flirtais c’était seulement avec la mort.
Il y a bien longtemps que je n’ai plus vécu seul mais je me souviens à quel point le fait d’être seul me donnait l’impression d’avoir la mort pour compagne.
Le morceau est ample et long comme une soirée passée en tête-à-tête avec soi-même à essayer de dompter ses démons.
Avec l’âge et l’expérience j’ai compris que la voie de l’équilibre psychique réside dans une subtile alternance entre moments vécus en société ou en famille et moments passés seul afin de se ressourcer, de se retrouver et s’accorder de la tranquillité et du repos.
Ce morceau et son chœur final puissant et propre à charrier l’eau du Styx fait partie des morceaux dont je suis le plus fier. Le texte n’est que métaphores. La gravité du propos n’en est que plus accrue. Je suis assez content aussi du jeu de mot discret au cœur du morceau : « Et même l’affamerait plutôt » qui peut se lire « Et même l’affemmerait plutôt », comme témoignage de la misère affective et sensuelle. Vivre seul c’est vivre dans l’ombre de soi-même. C’est se faire de l’ombre à soi- même. C’est être privé de la lumière de l’autre. C’est une soif jamais étanchée. C’est une faim jamais assouvie. C’est un manque jamais comblé. C’est un désir toujours frustré. C’est un projet de vie ajourné sine die. C’est ne connaître pour parfum que celui de ses testicules. C’est la gifle du quotidien sans la tendresse de l’autre pour apaiser la brûlure. C’est mourir à soi-même. C’est être vivant sans personne pour en attester. C’est douter même d’être en vie. C’est douter de tout. C’est chercher des preuves d’humanité. C’est une déchirure. C’est être séparé de l’être aimé qui n’est plus. C’est promener son désir séparé de son objet. C’est porter son amour à bout de bras sans personne pour nous en délester. C’est perdre à la loterie faute d’avoir joué et tenté la chance. C’est tenter le diable de la dépression. C’est être un panier percé et semer à tous les vents sa foutue tendresse. C’est mourir à petit feu quand on voudrait se réchauffer aux grandes flammes de l’amour conjugué. C’est être un soldat sans guerre. Un cerveau, une terre sans hémisphères. Une terre infertile. Un tas de gravats. Un lancer de cailloux perdu dans le vaste univers.
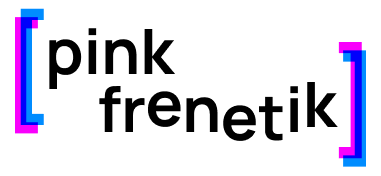
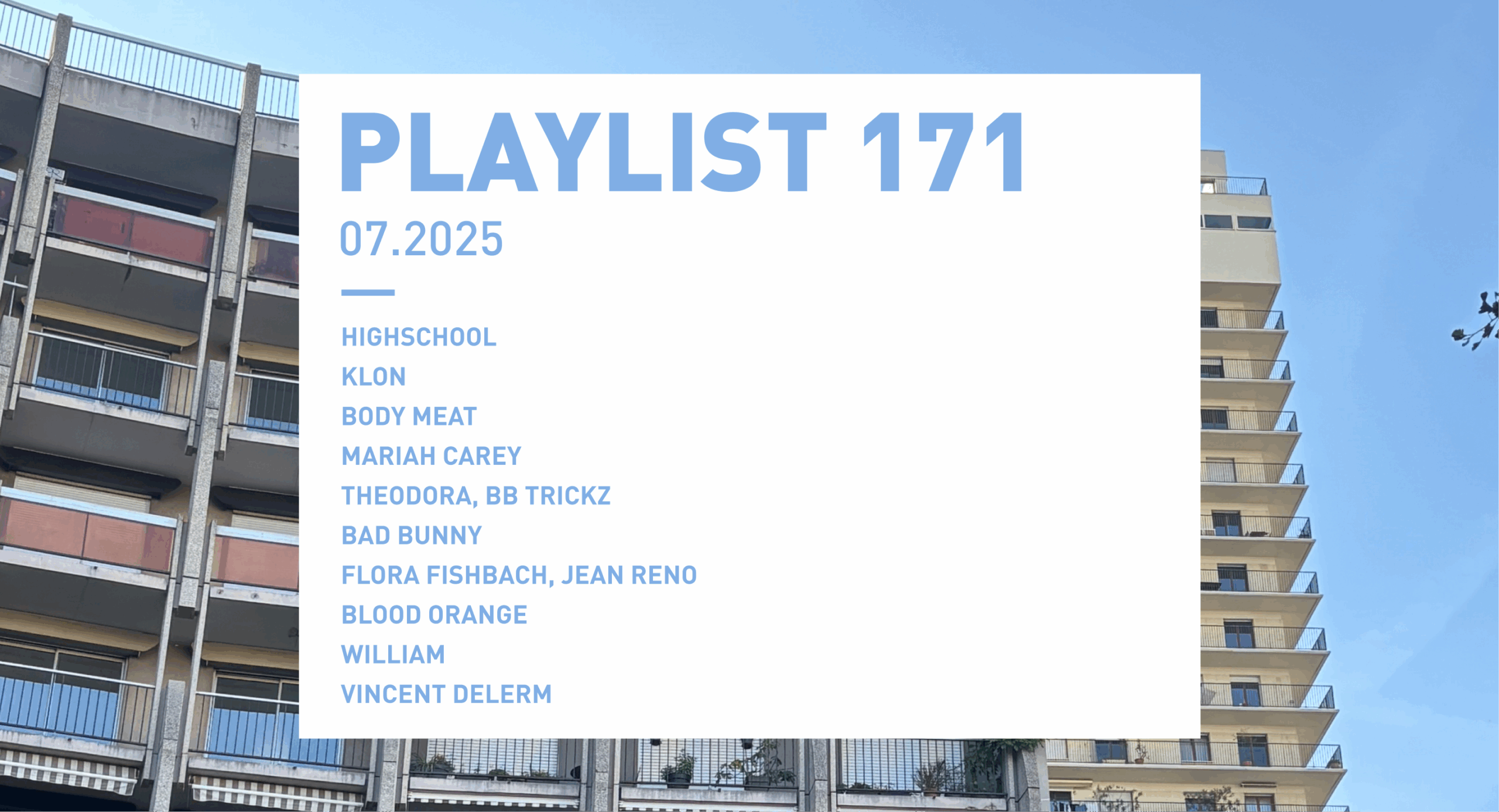
![[CLIP] Blood Orange – The Field](http://www.pinkfrenetik.com/wp-content/uploads/2025/06/clip-blood-orange-the-field-9.jpg)
![[CLIP] HighSchool – 149](http://www.pinkfrenetik.com/wp-content/uploads/2025/06/HighSchool-149.webp)

![[Entretien] Bertrand Betsch - Pour mémoire](http://www.pinkfrenetik.com/wp-content/uploads/2018/12/betrand-betsch-pour-memoire.jpg)




